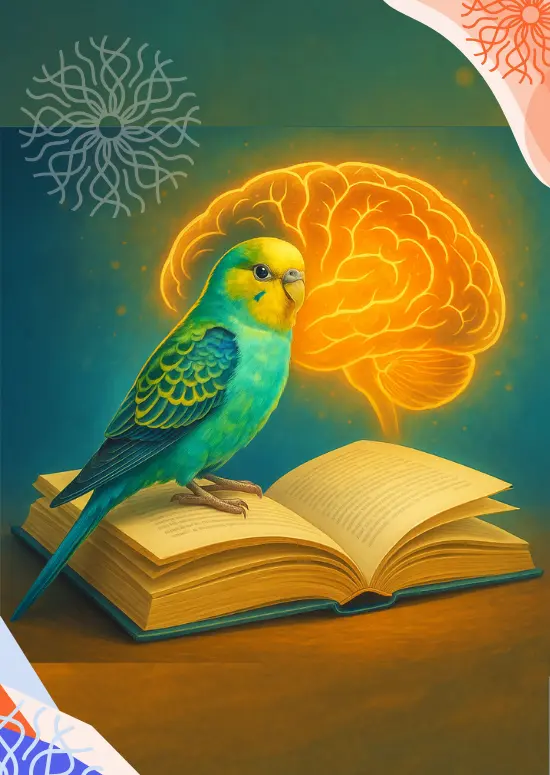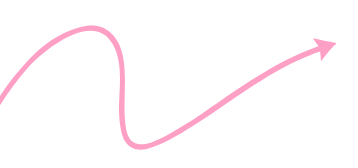- Introduction : au-delà des savoirs scolaires
- 1. La relation aux apprentissages : une source de motivation
- 2. Identifier les besoins derrière l’attitude d’élève
- 3. Aider à « devenir élève »
- 4. La sécurité, une condition première de l’apprentissage
- 5. Les fonctions cognitives au service des apprentissages
- 6. L’orientation dans le temps et l’espace
- 7. Clarifier, expliciter, ritualiser
- 8. Le langage : verbal et non verbal
- 9. Organiser l’espace et les supports
- 10. De la théorie à la pratique : un exemple concret
- Conclusion : accompagner pour libérer le potentiel
Introduction : au-delà des savoirs scolaires
Dans un contexte scolaire ou de formation, nous avons souvent tendance à focaliser nos efforts sur les apprentissages disciplinaires : lire, écrire, compter, résoudre un problème, analyser un texte, mémoriser une leçon. Pourtant, derrière ces apprentissages dits « scolaires », se cachent des besoins transversaux, qui conditionnent la réussite ou l’échec de tout projet éducatif.
Ces besoins éducatifs fondamentaux, liés au rapport à l’école, à la sécurité, à la motivation, à la mémoire, à l’attention, à l’orientation dans le temps et l’espace, sont souvent invisibles. Pourtant, lorsque nous savons les identifier et y répondre, nous créons un cadre éducatif sécurisé qui permet à chaque élève – y compris ceux en situation de handicap ou présentant des troubles neurodéveloppementaux – d’entrer dans les apprentissages avec plus de sérénité et de sens.
Pourquoi les besoins transversaux conditionnent la réussite
Les neurosciences de l’apprentissage ont montré que ces dimensions conditionnent directement l’activation ou l’inhibition des circuits cérébraux liés à l’apprentissage (attention, mémoire, langage, planification). Un cerveau en sécurité, qui saisit le sens de ce qu’il fait, et qui est stimulé à la bonne intensité développe sa plasticité et peut apprendre durablement.
Dans cet article, je vous propose de plonger au cœur de ces apprentissages transversaux. Nous verrons ensemble :
- Les outils pratiques pour organiser les espaces et clarifier les consignes.
- Pourquoi la relation aux apprentissages est l’une des clés de la motivation.
- Comment identifier les besoins observables derrière une attitude d’élève.
- Les leviers pour aider l’élève à devenir élève, au-delà des savoirs scolaires.
- L’importance de la sécurité, du cadre et du repérage.
- Le rôle central des fonctions cognitives (mémoire, attention, vitesse d’exécution).
- L’appui sur le langage verbal et non verbal.
1. La relation aux apprentissages : une source de motivation
Chaque apprenant, qu’il soit enfant ou adulte, entretient une relation singulière aux apprentissages. Cette relation ne se limite pas à « aimer » ou « ne pas aimer » l’école : elle est faite d’images mentales, d’attentes, de jugements sur la valeur du savoir, sur l’institution scolaire et sur soi-même comme apprenant.
Quand un élève ne voit pas de lien entre ce qu’on lui demande et sa vie, son quotidien ou ses projets, il peut manifester du désintérêt, de l’apathie, parfois de l’agressivité. Ce que nous interprétons souvent comme une « résistance » ou un « manque de motivation » est en réalité un signal : les apprentissages proposés sont trop éloignés de ses références culturelles ou de son univers personnel.
👉 Exemple concret : demander à un élève de résoudre des problèmes sur le prix des légumes au marché n’aura pas le même sens pour un enfant qui ne fait jamais les courses avec ses parents que pour celui qui aide chaque semaine sa famille.
Le défi de l’enseignant ou du formateur est donc de contextualiser, d’ancrer les savoirs dans des situations porteuses de sens.
🧠 Le système de récompense du cerveau (dopamine) ne s’active que si la tâche a une valeur personnelle, émotionnelle ou sociale. Pour éveiller l’engagement, il faut créer un état d’anticipation positive : un projet motivant, une perspective de réussite, un lien direct avec la vie réelle.
2. Identifier les besoins derrière l’attitude d’élève
Un élève ne s’assoit pas, ne sort pas son cahier, regarde par la fenêtre, refuse d’écrire. Que voyons-nous ? « Un manque de travail », « un refus d’apprendre » ? Peut-être. Mais souvent, ces comportements traduisent autre chose :
- Il ne comprend pas pourquoi il est à l’école.
- Il ne voit pas à quoi sert ce qu’on lui demande.
- Il est incapable de se fixer un objectif, même à court terme.
Ces observations doivent nous amener à questionner les besoins réels de l’élève :
- Donner du sens : proposer des projets qui résonnent avec sa vie.
- Relier les apprentissages à des objectifs concrets (ex. « savoir lire pour comprendre une recette », « savoir écrire pour envoyer un message »).
- S’appuyer sur ses centres d’intérêt pour l’amener progressivement vers les savoirs scolaires.
Autrement dit, avant de demander à un élève de devenir apprenant, il faut lui montrer pourquoi cela en vaut la peine.
🧠 Ces comportements peuvent aussi être lus comme des signaux de stress ou de désorganisation neurophysiologique. Le cerveau peut basculer dans des états d’hyperactivité ou d’hypoactivité (fuite, lutte, figement) selon l’état du système nerveux autonome.
Avant de raisonner, il faut parfois réguler le corps : pause, respiration, mouvement doux.
3. Aider à « devenir élève »
Pour certains enfants, notamment ceux présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) ou des troubles du comportement, « être élève » n’est pas une évidence. Ils arrivent à l’école sans avoir intériorisé les codes sociaux et scolaires : rester assis, écouter, attendre son tour, collaborer avec les autres.
Dans ces cas, l’accompagnement vise d’abord à sécuriser l’élève et construire un cadre contenant et rassurant.
Quelques leviers concrets :
- Ritualiser l’entrée à l’école et dans la classe. Les rituels donnent un cadre prévisible, donc rassurant.
- Favoriser la rencontre avec les adultes en nommant clairement leur fonction.
- Installer l’élève à une place stable avec des objets familiers.
- Ne pas multiplier les changements de repères qui génèrent de l’angoisse.
L’objectif n’est pas seulement d’apprendre à lire ou à compter : c’est d’abord d’entrer dans le rôle d’élève, ce qui est déjà un apprentissage à part entière.
🧠 Le rôle d’élève mobilise fortement le cortex préfrontal, zone impliquée dans l’inhibition, l’attention, la planification. Il est encore en développement jusqu’à l’âge adulte. Chaque stabilisation émotionnelle favorise son fonctionnement, et donc, la disponibilité à apprendre.
4. La sécurité, une condition première de l’apprentissage
On oublie parfois que la toute première mission de l’école est d’assurer la sécurité des élèves. Pour certains enfants, cela signifie anticiper des mises en danger : fugues, escalade de grillages, ingestion d’objets, agressions envers d’autres élèves.
Cela demande :
- De sécuriser les lieux et objets dangereux.
- De surveiller de manière accrue les déplacements.
- De contenir physiquement si nécessaire (en dernier recours).
Mais la sécurité ne se limite pas au physique : il s’agit aussi de créer un climat psychologique contenant, où l’élève se sent reconnu, apaisé, capable de se repérer.
👉 Un enfant qui vit dans l’insécurité permanente ne peut pas apprendre.
🧠 En situation d’insécurité, le cerveau active l’amygdale (alerte), et inhibe le cortex préfrontal (raisonnement, langage, mémoire). L’enfant est en mode survie. Il faut d’abord rétablir un état de sécurité relationnelle pour rouvrir la porte des apprentissages.
5. Les fonctions cognitives au service des apprentissages
Au-delà des comportements, l’accompagnement doit aussi prendre en compte les capacités cognitives de chaque apprenant. Trois dimensions sont essentielles :
a. La mémoire
- Mémoire de travail : capacité à retenir temporairement quelques informations.
- Mémoire à long terme : ancrage durable des connaissances.
- Stratégies de mémorisation : utilisation de techniques adaptées.
b. L’attention
- Durée : combien de temps l’élève reste concentré.
- Sélection : sur quoi il choisit de porter son attention.
- Qualité : sa capacité à ne pas se disperser.
c. La vitesse d’exécution
Certains élèves sont très rapides, d’autres beaucoup plus lents. L’un n’est pas « meilleur » que l’autre : cela indique simplement des besoins d’adaptation (temps supplémentaire, entraînement, automatisation).
👉 Adapter la pédagogie, c’est accepter que les rythmes et les ressources cognitives varient d’un élève à l’autre.
🧠 Le cortex préfrontal est très sollicité par les tâches qui demandent planification, mémoire de travail et flexibilité. Il est sensible au stress et à la fatigue. Prévoir des pauses, des tâches brèves, et du soutien visuel est essentiel pour ne pas surcharger la charge cognitive.

« Il s’agirait moins d’exiger une posture d’apprenant que de créer les conditions qui permettent à cette posture d’émerger. »
— Catherine EYMERY, 2012
6. L’orientation dans le temps et l’espace
Savoir se repérer dans le temps et s’orienter dans l’espace ne va pas de soi pour tous les élèves. Et pourtant, ce sont des compétences transversales essentielles à l’autonomie, à la compréhension des consignes et à la gestion des apprentissages.
🧠 Ces capacités dépendent notamment de l’hippocampe (mémoire spatiale et temporelle) et des lobes pariétaux, qui traitent les relations spatiales et la perception du mouvement dans le temps. Lorsqu’ils sont peu sollicités ou peu structurés, les élèves peuvent se retrouver en état de confusion cognitive.
Difficultés fréquemment observées :
- Confusion entre hier, aujourd’hui et demain.
- Difficulté à comprendre les connecteurs temporels comme « avant », « ensuite », « en même temps ».
- Désorientation spatiale : ne pas savoir où se trouvent les affaires, les lieux, ou les directions dans la classe, l’école ou la ville.
Ces obstacles peuvent générer de l’anxiété, un sentiment d’échec ou une forme de retrait passif.
👉 Heureusement, de petits ajustements pédagogiques peuvent avoir un impact majeur :
- Supports visuels du temps : emploi du temps affiché avec pictogrammes, frises chronologiques illustrées, timers visuels pour structurer la durée.
- Construction progressive du vocabulaire temporel et spatial : jeux de langage, étiquettes, mises en situation concrètes.
- Utilisation de repères visuels spatiaux : plans simplifiés, balisage en couleur dans la classe, coins bien identifiés (coin lecture, coin calme…).
- Adaptation des supports écrits : simplifier les schémas, utiliser des légendes claires, insérer des repères de position (gauche/droite, début/fin, haut/bas).
🎯 L’objectif n’est pas uniquement que l’élève sache « lire l’heure » ou « suivre un plan », mais qu’il développe une capacité à se situer, à anticiper, à s’organiser — autant de prérequis pour entrer sereinement dans les apprentissages scolaires.
🧠 À force de stimulations régulières, dans un cadre stable et explicite, ces fonctions se renforcent : c’est la neuroplasticité en action, au service de la structuration de l’esprit.
7. Clarifier, expliciter, ritualiser
Un levier fondamental – et pourtant souvent sous-estimé – pour sécuriser et mobiliser les apprentissages consiste à rendre explicite ce qui ne l’est pas. Trop souvent, nous supposons que l’élève sait pourquoi il fait l’exercice, ce qu’on attend de lui, ou comment s’y prendre.
En réalité, pour de nombreux enfants – notamment ceux ayant des troubles du langage, des fonctions exécutives ou de la compréhension – ces éléments implicites constituent de véritables zones d’ombre.
🎯 Clarifier, c’est éclairer le chemin cognitif avant même de commencer.
Trois principes simples font toute la différence :
- Expliquer le sens de la tâche : « Nous faisons cet exercice pour apprendre à… » → cela active le cortex préfrontal et donne une direction à l’effort.
- Découper et simplifier les consignes : une étape à la fois, avec un vocabulaire clair, des mots-clés mis en évidence (couleur, gras, pictogramme).
- Installer des rituels pédagogiques : une structure répétée, connue, qui stabilise l’environnement et réduit l’incertitude cognitive.
👉 Exemple de mise en pratique => avant de commencer un exercice :
- Relire la consigne ensemble.
- Demander à l’élève de la reformuler avec ses mots.
- Montrer un exemple de production attendue.
🧠 Le cerveau apprend mieux dans la prévisibilité. Cela réduit l’activation de l’amygdale (centre de l’alerte), libère des ressources pour le raisonnement, et facilite l’encodage en mémoire à long terme.
Les rituels, quant à eux, créent des ancrages neuronaux stables, essentiels pour les élèves ayant besoin de repères fixes pour s’engager.
👉 Clarifier et ritualiser, c’est sécuriser sans simplifier, c’est rendre l’élève acteur en le guidant pas à pas, sans le laisser dans le flou ou la devinette.
8. Le langage : verbal et non verbal
Pour de nombreux élèves — en particulier ceux présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une dysphasie, une déficience intellectuelle ou un trouble du langage oral — le langage verbal seul ne suffit pas.
🧠 Leur compréhension est souvent entravée par des difficultés d’accès aux mots, d’organisation syntaxique ou d’abstraction. Or, le cerveau visuel, notamment le gyrus fusiforme et les voies occipito-temporales, traite les images plus rapidement et plus efficacement que le texte, surtout en situation de stress ou de surcharge cognitive.
👉 En intégrant systématiquement des codes non verbaux (pictogrammes, gestes, schémas, mimiques), on renforce la clarté du message et on soulage la mémoire de travail.
Ces appuis visuels permettent de :
- Clarifier le vocabulaire : un mot accompagné d’une image devient plus accessible.
- Soutenir la compréhension des consignes : une frise ou une séquence imagée aide à visualiser les étapes d’une tâche.
- Créer des représentations mentales durables : en associant le mot, le geste et l’image, on ancre le sens dans plusieurs canaux sensoriels.
- Compenser les troubles du langage : en facilitant l’entrée dans la tâche même en cas de compréhension orale limitée.
👉 Exemple : pour l’action « lire », on peut montrer une image de livre ouvert + faire le geste d’ouverture + prononcer le mot lentement. Pour une consigne complexe, une frise illustrée étape par étape devient un véritable fil conducteur cognitif.
🎯 La multimodalité n’est pas une simplification : c’est une stratégie d’inclusion et de consolidation. Elle active davantage de circuits neuronaux, et rend l’apprentissage plus robuste, accessible et transférable.
9. Organiser l’espace et les supports
L’attention est une ressource limitée, encore plus fragile chez les élèves présentant des troubles de l’apprentissage, de l’attention ou de la régulation sensorielle.
🧠 Lorsque l’environnement est visuellement ou auditivement surchargé — affichages abondants, matériel éparpillé, bruit ambiant — le cerveau mobilise ses ressources pour filtrer les distractions plutôt que pour traiter l’information essentielle. Cela augmente la charge cognitive extrinsèque, au détriment de la concentration et de la mémorisation.
👉 Un espace bien pensé devient un partenaire pédagogique : il guide l’attention, apaise le système nerveux et soutient la mise au travail.
Quelques leviers efficaces :
- Limiter le matériel à l’essentiel : un plateau, une tâche. Le superflu encombre l’attention.
- Structurer les supports visuellement : zones bien délimitées, encadrés, pictogrammes pour chaque étape.
- Alléger l’environnement visuel : éviter l’accumulation d’affiches, préférer des repères clairs, utiles et cohérents.
- Proposer des outils de soutien : sous-mains, marque-pages visuels, mémos plastifiés avec pictogrammes ou étapes types.
🧠 Ces aménagements soutiennent notamment le fonctionnement du cortex préfrontal, qui gère la planification, l’organisation spatiale et la gestion du double-tâche. En diminuant les distractions externes, on libère de l’espace mental pour que l’élève se concentre sur l’essentiel.
👉 En pédagogie, moins, c’est souvent mieux : un support simple, lisible, bien organisé, vaut mieux que dix fiches complexes, même riches en contenu.
10. De la théorie à la pratique : un exemple concret
Prenons une fiche d’exercice en géographie, telle qu’elle est souvent proposée en classe :
- Une carte en noir et blanc, peu lisible, sans légende visuelle.
- Des consignes longues, denses, rédigées dans une police trop petite.
- Un espace de réponse étroit, qui ne permet pas à l’élève de s’exprimer correctement.
🧠 Pour un élève en difficulté — qu’il soit DYS, allophone, en situation de stress ou simplement en surcharge cognitive — ce type de support constitue un véritable obstacle à l’entrée dans la tâche. Il ne s’agit plus d’évaluer ses compétences en géographie, mais sa capacité à décoder un dispositif complexe.
👉 En procédant à quelques adaptations simples, on peut transformer ce frein en levier d’apprentissage :
- Coloriser la carte : différencier visuellement les mers et les terres, ajouter des pictogrammes ou une légende colorée facilite le repérage spatial (activation du cortex occipito-temporal).
- Aérer les consignes : les découper en étapes numérotées, utiliser une police lisible (Arial 14 ou OpenDyslexic), insérer des mots-clés en gras ou en couleur.
- Agrandir l’espace de réponse : offrir une zone de production suffisamment large encourage l’élève à formuler une pensée complète, sans stress ni contraintes motrices.
- Présenter un exemple réalisé : modéliser le résultat attendu réduit l’ambiguïté et soutient la motivation.
🎯 Ces ajustements ne dénaturent pas l’objectif de l’exercice — ils le rendent accessible, donc potentiellement réussi. Car l’objectif n’est pas seulement de « faire l’exercice », mais de permettre à l’élève de vivre une expérience d’apprentissage positive et valorisante, condition essentielle à la construction de sa confiance et de sa motivation.
Conclusion : accompagner pour libérer le potentiel
Répondre aux besoins transversaux des élèves, ce n’est pas « faire du hors programme ». C’est au contraire créer les conditions qui rendent les apprentissages possibles.
Un élève qui se sent en sécurité, qui comprend le sens de ce qu’il fait, qui a des outils adaptés à son rythme et à ses capacités, devient capable de mobiliser ses ressources cognitives et affectives pour apprendre.
En tant que formateurs, enseignants ou accompagnants, notre rôle n’est pas seulement de « transmettre des savoirs ». C’est de créer un environnement d’apprentissage inclusif, sécurisant et motivant, où chaque apprenant peut devenir pleinement acteur de son parcours.
🧠 Le cerveau apprend mieux lorsqu’il est en lien, en mouvement, et en confiance. Favorisons les contextes où il peut déployer sa plasticité et développer des circuits durables.
Et souvenons-nous : aider un élève à devenir élève, c’est déjà lui donner une clé pour la vie.
📲 Tu veux des exemples concrets, des outils visuels et des inspirations pédagogiques ? Rejoins-moi sur Instagram pour continuer la discussion : https://www.instagram.com/cateymery/