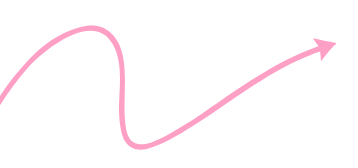- TDAH un enjeu clé pour les formatrices et formateurs
- 1. Le TDAH : un fonctionnement neurologique, pas une question de volonté
- 2. Comment le TDAH peut se manifester dans un contexte de formation
- 3. Adapter ta posture et tes dispositifs pédagogiques
- 4. Mieux repérer pour mieux accompagner le TDAH
- Conclusion : Vers une formation “neuro-adaptée”
TDAH un enjeu clé pour les formatrices et formateurs
TDAH et formation : un duo souvent ignoré, mais pourtant déterminant. En tant que formatrice ou formateur, tu interviens auprès de profils très divers. Certains apprenants sont enthousiastes et engagés, d’autres plus discrets ou hésitants. Et parfois, tu rencontres des personnes qui semblent désorganisées, en retard, inattentives ou démotivées.
Derrière ces comportements se cache parfois un fonctionnement cognitif atypique : le TDAH — trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Bien qu’encore trop souvent non diagnostiqué à l’âge adulte, ce profil neurodéveloppemental impacte profondément l’apprentissage, la gestion du temps, la motivation et l’organisation.
Non, ce n’est pas une question de paresse ni de mauvaise volonté. C’est une autre manière de fonctionner, qui peut devenir un frein… ou un formidable levier si le cadre pédagogique est ajusté.
👉 Adapter ta pédagogie au TDAH, ce n’est pas faire du « cas par cas ». C’est rendre ton accompagnement plus inclusif, plus agile et surtout plus efficace pour tous.
Dans cet article, tu vas découvrir :
- Ce que le TDAH est (et n’est pas)
- Comment il se manifeste en formation
- Quelles stratégies pédagogiques concrètes adopter
- Comment mieux repérer et accompagner les adultes concernés, avec une approche globale et bienveillante
En intégrant les particularités des profils neuroatypiques dans ta posture, tu participes à une formation plus humaine, plus performante… et en phase avec les enjeux actuels de l’apprentissage pour adultes.
1. Le TDAH : un fonctionnement neurologique, pas une question de volonté
Avant de proposer des pistes pédagogiques concrètes, il est essentiel de comprendre en profondeur le fonctionnement neurologique des personnes concernées par le TDAH. Trop souvent perçu à tort comme un manque de motivation ou un simple problème de comportement, ce trouble repose en réalité sur des mécanismes cognitifs spécifiques. Voici les éléments-clés à garder à l’esprit pour mieux ajuster ton accompagnement.
1.1 Un trouble du neurodéveloppement ancré dès l’enfance
Le TDAH — trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité — n’apparaît pas soudainement à l’âge adulte. C’est un profil neurologique qui se met en place dès l’enfance, même si ses signes peuvent évoluer, se masquer ou se compenser avec le temps. Il se manifeste souvent par une instabilité attentionnelle, une impulsivité marquée et des difficultés d’organisation. Mais ce n’est qu’une partie du tableau.
Contrairement à ce que suggère l’acronyme, il ne s’agit pas d’un déficit pur et simple, mais d’une dysrégulation cognitive contextuelle. L’attention n’est pas absente : elle est fluctuante, parfois excessive (hyperfocus), parfois insaisissable. Le cerveau fonctionne différemment selon l’environnement, les émotions, les stimulations et les enjeux perçus.
Ce profil devient un trouble à partir du moment où il crée un véritable handicap dans la vie quotidienne : au travail, dans les relations, dans les apprentissages. Lorsqu’il n’y a pas d’impact majeur mais que les traits existent (inattention, hyperactivité, besoin de mouvement, sensibilité émotionnelle…), on parle plutôt de neurodivergence — une variation du fonctionnement cognitif, et non une pathologie.
1.2 Des mécanismes cérébraux qui modifient la motivation et l’action
Pour saisir pourquoi un apprenant avec TDAH a du mal à démarrer, à terminer ou à rester concentré sur une tâche, il faut explorer certains rouages du cerveau :
- Le système exécutif, situé dans le cortex préfrontal, pilote des fonctions clés : planification, inhibition, gestion du temps, maintien de l’effort. Lorsqu’il est fragilisé, structurer une tâche devient laborieux, voire inaccessible.
- Le système dopaminergique — moteur de la motivation, de la récompense et de la concentration — est souvent moins réactif. Résultat : l’effort cognitif semble disproportionné face au bénéfice perçu.
- Lorsque la tâche paraît ennuyeuse, abstraite ou trop éloignée dans le temps, le cerveau décroche. Il cherche des stimulations immédiates, quitte à reporter les obligations importantes.
- C’est ce qu’on nomme la myopie du futur : une difficulté à se projeter, à visualiser les étapes d’un projet long, à percevoir concrètement les conséquences différées.
Ce fonctionnement explique la tendance à la procrastination, suivie de “rushs” de dernière minute. Le cerveau réagit mieux à l’urgence qu’à la planification abstraite. Le stress devient alors un déclencheur temporaire de mobilisation, mais au prix d’une grande fatigue cognitive.
1.3 Variabilité, hyperfocus et fluctuations quotidiennes
Le fonctionnement attentionnel des personnes avec TDAH est tout sauf linéaire. Un jour productives, le lendemain dispersées, elles peuvent passer d’un état de désengagement complet à une concentration extrême sur un sujet qui les passionne. C’est ce qu’on appelle l’hyperfocus — une immersion totale dans une tâche, parfois jusqu’à l’oubli du temps et de l’environnement.
Ce phénomène peut susciter confusion ou frustration : « Elle en est capable, pourquoi ne fait-elle pas pareil ailleurs ? ». En réalité, la capacité est là, mais elle ne se déclenche que dans certaines conditions. Comprendre cette variabilité naturelle permet d’accompagner avec plus de justesse, sans étiqueter ou infantiliser.
Accepter ces fluctuations cognitives, c’est faire le choix d’une pédagogie souple, inclusive et fondée sur les forces plutôt que sur les manques.
🗝️ Clé à retenir : Le TDAH n’est pas un manque de volonté, mais un fonctionnement neurologique atypique. Adapter ta pédagogie commence par une meilleure connaissance de ces mécanismes.
2. Comment le TDAH peut se manifester dans un contexte de formation
Reconnaître les signaux du TDAH chez un apprenant est une première étape essentielle pour ajuster ton accompagnement. Ces manifestations ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles peuvent impacter fortement le parcours de formation. En tant que formatrice ou formateur, être attentif·ve à ces indices permet d’anticiper les blocages, d’adapter les rythmes, et d’éviter la stigmatisation.
2.1 Comportements fréquents observables
Voici une liste non exhaustive de comportements couramment observés chez des apprenants avec un profil TDAH :
- Retards récurrents dans la remise des livrables, malgré une intention claire de s’y atteler.
- Difficulté à planifier ou à prioriser : tendance à commencer par les tâches les plus plaisantes ou les plus faciles, en repoussant les plus complexes.
- Surcharge cognitive rapide lors de sessions longues ou monotâches.
- Passages fréquents d’un sujet à l’autre sans finalisation (effet “zapping” cognitif).
- Hypersensibilité aux distractions : bruits, mouvements, pensées envahissantes, notifications.
- Alternance marquée entre des phases de concentration intense (hyperfocus) et des phases d’inertie mentale.
- Sentiment d’impuissance ou de découragement : “je sais ce que je dois faire, mais je n’y arrive pas”.
- Mobilisation tardive et intense juste avant une échéance : montée d’adrénaline compensatoire, souvent épuisante.
2.2 Impacts typiques sur le parcours de formation
Ces comportements, s’ils ne sont pas compris ou accompagnés, peuvent générer des effets en cascade sur le déroulement du parcours d’apprentissage :
- Perte de motivation progressive, jusqu’à l’abandon silencieux ou au décrochage brutal.
- Besoin accru de feedbacks fréquents et de validation à court terme pour rester engagé.
- Désintérêt rapide face à des contenus trop linéaires, théoriques ou peu interactifs.
- Difficulté à structurer l’information et à organiser la mémoire de travail.
- Vulnérabilité accrue dans les formations à distance ou auto-dirigées sans cadre solide.
- Sentiment de décalage ou d’imposture, notamment si les résultats ne reflètent pas les efforts fournis.
Ces impacts ne sont pas une fatalité. Une fois repérés, ils ouvrent la voie à des stratégies d’adaptation efficaces, aussi bien pour l’apprenant que pour toi, en tant que professionnelle ou professionnel de la pédagogie.
🗝️ Clé à retenir : Reconnaître les signes du TDAH en formation permet d’ajuster ton accompagnement en amont et d’éviter l’exclusion silencieuse de profils pourtant engagés.

« Les attitudes professionnelles propices à l’émergence de la capacité inventive sont celles qui permettent aux personnes accompagnées de se sentir reconnues dans leur singularité, accueillies dans leur rythme et considérées dans leur manière d’apprendre. »
— Catherine Eymery, 2012, p. 278
3. Adapter ta posture et tes dispositifs pédagogiques
En tant que professionnelle de la formation, tu joues un rôle essentiel dans l’environnement cognitif des apprenants. On peut dire que tu agis comme un véritable “buffer neuronal” : un filtre bienveillant qui rend le cadre d’apprentissage plus lisible, plus accessible, et surtout plus respectueux des différences cognitives. C’est particulièrement vrai pour les personnes vivant avec un TDAH, dont les besoins en structure, clarté et souplesse sont spécifiques. Voici les piliers d’une pédagogie adaptée.
3.1 Adopter une posture d’accueil et installer un climat de confiance
Avant toute technique, c’est la posture qui compte. Une relation pédagogique sécurisante permet aux profils atypiques de se mobiliser avec plus de fluidité.
- Valoriser les forces : créativité, intuition, pensée associative rapide, spontanéité, capacité à faire des liens inattendus.
- Éviter la stigmatisation envers les autres : privilégier des termes comme “fonctionnement cognitif singulier” ou “style attentionnel particulier” plutôt que “trouble”.
- Encourager l’expérimentation : normaliser les essais-erreurs, les détours et les réajustements comme des étapes naturelles de l’apprentissage.
- Pratiquer la transparence pédagogique : toujours expliquer le pourquoi des consignes, des outils ou des méthodes. Cela aide à projeter dans le temps et à (re)donner du sens.
- Instaurer un cadre souple mais clair : règles de fonctionnement explicites, sans rigidité excessive, pour que chacun·e sache où il/elle va.
3.2 Structurer les contenus pour alléger la charge mentale
Les apprenants avec TDAH bénéficient d’une organisation pédagogique visuelle, séquencée et progressive. Il s’agit de structurer le parcours sans le rigidifier.
- Fractionner les tâches : découper les objectifs en micro-étapes courtes, réalisables et motivantes.
- Rythmer les sessions : alterner les modalités (contenu, pratique, pause, discussion) pour maintenir l’attention active.
- Fixer des micro-objectifs accompagnés de micro-récompenses : chaque avancement devient une source de satisfaction (checklist, badge, retour valorisant).
- Aider à visualiser le parcours : cartes mentales, frises chronologiques, tableaux de progression, timelines par modules.
- Réduire la charge cognitive : consignes simples, supports allégés, exemples concrets, canevas pour aider à démarrer.
- Créer des points de repère : check-ins réguliers, points d’étape, feedbacks intermédiaires, jalons visibles.
3.3 Intégrer des outils et méthodes concrets, adaptés au fonctionnement attentionnel
Le choix des outils pédagogiques peut profondément changer l’expérience d’un apprenant neuroatypique. Voici des leviers à activer :
- Méthode Pomodoro : séquences de 25–30 minutes de concentration suivies de 5 minutes de pause active.
- Agenda visuel ou planning anticipé : fournir une vue globale du parcours avec des échéances bien positionnées.
- Rituel “intention du jour” : demander à l’apprenant ce qu’il/elle veut accomplir dans la session (objectif clair = engagement renforcé).
- Tableaux de bord de progression : permettre à chacun de visualiser ses avancées (barres de progression, indicateurs simples, couleurs, etc.).
- Apps de gestion des tâches : outils simples de type Trello, Todoist, ou Notion avec rappels automatiques.
- Régulation émotionnelle : intégrer des moments courts de respiration, méditation guidée ou étirement en début/fin de séance pour relancer la concentration.
- Binômes de travail (pairing) : encourager le co-apprentissage, la relecture mutuelle, les tandems de soutien.
- Supports multimédias variés : vidéos courtes, infographies, schémas, podcasts, fiches visuelles. Multiplier les canaux aide à maintenir l’engagement.
En mettant en œuvre ces adaptations concrètes, tu permets à chaque apprenant·e de mobiliser son plein potentiel, quelle que soit sa manière de fonctionner. C’est aussi ça, la pédagogie inclusive.
🗝️ Clé à retenir : Une pédagogie adaptée au TDAH repose sur trois piliers : souplesse, structure claire et outils concrets. C’est toute ta démarche qui en bénéficie, pas seulement les profils atypiques.
4. Mieux repérer pour mieux accompagner le TDAH
Comprendre les mécanismes du TDAH chez l’adulte est une étape essentielle pour proposer un accompagnement adapté, sans jugement ni simplification excessive. Ce trouble, souvent réduit à tort à de « simples troubles du comportement », mérite une attention plus fine. Décryptons ensemble les origines, les manifestations et les solutions envisageables.
4.1 Le TDAH, bien plus qu’une hyperactivité chez l’enfant
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est souvent associé aux enfants « remuants ». Pourtant, chez l’adulte, les symptômes se transforment et deviennent plus insidieux :
- procrastination chronique,
- distraction constante,
- oublis répétés,
- désorganisation,
- difficulté à gérer les priorités.
Ces manifestations ne sont pas dues à un manque d’effort ou de volonté. Elles découlent d’un dysfonctionnement des circuits cérébraux, en particulier ceux régulés par la dopamine et la noradrénaline.
Contrairement aux idées reçues, le TDAH à l’âge adulte ne disparaît pas, il évolue. De nombreuses personnes reçoivent leur diagnostic tardivement, souvent après des années d’incompréhension et de culpabilité. Cette prise de conscience permet enfin d’agir.
4.2 Origines du TDAH : entre terrain génétique et facteurs environnementaux
Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental dont les causes sont multifactorielles. Il est important de déconstruire l’idée reçue selon laquelle il serait dû à une mauvaise éducation.
🧬 Composante génétique forte :
Lorsqu’un parent est concerné, le risque est significativement plus élevé pour l’enfant.
🌱 Facteurs environnementaux aggravants :
- stress pendant la grossesse,
- carences affectives,
- traumatismes précoces,
- environnement scolaire inadapté.
🧠 Déséquilibre neurochimique :
Les circuits dopaminergiques (motivation, plaisir, récompense) et noradrénergiques (vigilance, attention) sont souvent sous-activés. Résultat ? Le cerveau peine à se mobiliser sans stimulation forte, expliquant pourquoi une tâche « banale » semble insurmontable, alors qu’une urgence peut générer une concentration intense.
4.3 Quelles solutions pour mieux vivre avec un TDAH adulte ?
L’accompagnement du TDAH chez l’adulte repose sur une approche globale et personnalisée. Une prise en charge individualisée, combinant plusieurs leviers, peut améliorer significativement la qualité de vie au quotidien.
💊 Traitement médicamenteux
Les psychostimulants comme le méthylphénidate sont souvent prescrits pour favoriser la régulation attentionnelle et émotionnelle. Ils ne guérissent pas le TDAH, mais peuvent offrir un soutien ponctuel, notamment pour initier une démarche thérapeutique. Cela dit, leur usage reste controversé. Pour ma part, je préfère éviter cette classe de substances, dérivée de la cocaïne, qui agit directement sur la production de dopamine. Chacun doit évaluer ses propres besoins, ses ressentis et ses limites face aux effets secondaires potentiels tels que des retards de croissance.
🧠 Psychoéducation
Mieux connaître son fonctionnement cognitif permet d’adapter ses routines, d’identifier ses déclencheurs et de mettre en place des stratégies concrètes :
- Amélioration de l’hygiène de sommeil,
- Activité physique régulière,
- Alimentation équilibrée,
- Utilisation d’outils de gestion du temps (agenda visuel, timer, batch working, etc.).
🧘♀️ Thérapies spécifiques
Les TCC (thérapies cognitivo-comportementales) sont particulièrement recommandées pour le TDAH adulte. Elles aident à restructurer les pensées automatiques et à organiser les tâches. D’autres approches comme la pleine conscience ou le neurofeedback ont également démontré leur efficacité pour renforcer l’attention, la concentration et l’autorégulation émotionnelle.
🔧 Aménagements pratiques
L’environnement joue un rôle essentiel. Mettre en place des rituels simples et des repères visuels permet de réduire la charge cognitive :
- Soutien familial, coaching individuel ou accompagnement en groupe.
- Outils visuels : tableaux, post-it, alarmes, codes couleurs,
- Rituels courts et répétés (routine du matin, check-list, etc.),
🗝️ Clé à retenir : Repérer le TDAH adulte, c’est aussi connaître les leviers d’accompagnement : thérapie, outils, environnement et postures favorables. Ce n’est jamais trop tard pour agir.
Conclusion : Vers une formation “neuro-adaptée”
Pour toi, formatrice, intégrer une approche éclairée du TDAH en formation n’est pas un supplément « pédagogique spécial » ni une contrainte. C’est une véritable preuve de maturité professionnelle, d’écoute et d’agilité pédagogique. Cela enrichit ton dispositif, améliore la rétention des apprenants et rend ta pédagogie plus inclusive et plus équitable.
Voici les points clés à retenir :
- Le TDAH n’est pas de la paresse, mais une dysrégulation cognitive : le cerveau peine à prioriser, à maintenir l’attention et à filtrer les distractions.
- Les apprenants concernés ont besoin de structure claire, de retours fréquents, d’une segmentation des apprentissages et de récompenses immédiates.
- Ton dispositif pédagogique peut soutenir leur neuroplasticité via la répétition cadrée, la variation des canaux sensoriels et le feedback régulier.
- Inclure ces profils dans ta démarche favorise une meilleure dynamique de groupe : plus d’authenticité, plus de créativité, et un vrai climat de confiance.
- Les leviers comme la modulabilité, la différenciation, la métacognition ou encore l’autonomie guidée feront toute la différence dans leur parcours d’apprentissage.
👉 Et si tu veux aller plus loin, je peux t’aider à créer un module de formation clé en main, avec :
- Supports pédagogiques adaptés,
- Séquences structurées pour les profils TDAH,
- Outils concrets à utiliser dès demain avec tes groupes.
🗝️ Clé finale à retenir : En intégrant ces repères dans ta posture, tu renforces une pédagogie à la fois inclusive, exigeante et respectueuse des singularités.
Si tu cherches quelques outils ou idées pour adapter ton accompagnement, je peux t’en partager avec plaisir. N’hésite pas à me le demander simplement en DM sur mon Instagram.
Eymery, C. (2012). Attitudes caractéristiques des enseignants et/ou formateurs favorisant la mise en place d’inventions révélatrices du professionnel dit ingenium (Thèse de doctorat inédite). Université de Toulouse II – Le Mirail.