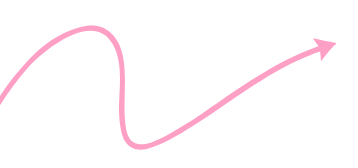- 1. La perruche, une virtuose de l’improvisation : inspiration pour la pédagogie et la plasticité cérébrale
- 2. L’importance de la structure : base de la pédagogie et de la plasticité cérébrale
- 3. Le rôle de la préparation mentale en pédagogie et plasticité cérébrale
- 4. Plasticité cérébrale et pédagogie : moteur de la progression
- Conclusion : que retenir pour notre pédagogie ?
Et si votre pédagogie pouvait s’inspirer de la plasticité cérébrale… et d’une perruche ? Vous vous demandez sans doute : « Quel rapport entre une perruche et la pédagogie ? » Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un délire exotique ni d’un cours d’ornithologie. Mais d’une plongée fascinante dans le cerveau d’un oiseau qui pourrait bien transformer notre manière d’enseigner et d’apprendre.
Une récente étude scientifique1 s’est penchée sur la perruche ondulée2, un petit perroquet célèbre pour sa capacité à imiter des sons, y compris la parole humaine. Les chercheurs ont découvert que, tout comme nous, cet oiseau dispose d’un véritable « centre moteur vocal » dans son cerveau, qui lui permet de recombiner des modules pour créer des vocalisations variées. Une organisation qui ressemble étonnamment à celle de notre cortex moteur impliqué dans la parole.
Au-delà de la curiosité scientifique, ces découvertes nous offrent une leçon puissante sur la plasticité, la modularité et la créativité pédagogique. Cette comparaison révèle à quel point la pédagogie et plasticité cérébrale sont intimement liées et peuvent s’enrichir mutuellement.
1. La perruche, une virtuose de l’improvisation : inspiration pour la pédagogie et la plasticité cérébrale
Chez l’humain, la parole nécessite un contrôle moteur extrêmement précis. Elle implique de coordonner la respiration, les muscles de la gorge, de la langue, du visage… et tout cela est piloté par notre cortex moteur vocal, finement organisé.
La perruche ondulée, elle aussi, possède un réseau cérébral spécialisé, appelé AAC (noyau central de l’arcopallium antérieur)3. Ce réseau est capable d’activer et de « recycler » des ensembles neuronaux pour produire des sons variés. Autrement dit, l’oiseau ne répète pas mécaniquement des sons appris, il assemble et module ses « briques » vocales pour improviser.
1.1. La préparation mentale : un atout pour la pédagogie et la plasticité cérébrale
Point clé : L’AAC s’active avant même la production du son, prouvant que la préparation mentale est essentielle. La perruche ne « subit » pas sa voix, elle l’anticipe, la sculpte et l’adapte en temps réel.
Ce phénomène nous montre à quel point la visualisation et l’anticipation jouent un rôle crucial dans tout apprentissage, qu’il soit vocal ou moteur. Chez les humains, préparer un discours, répéter mentalement un geste sportif ou imaginer un enchaînement avant de le réaliser active déjà les réseaux neuronaux impliqués. Cette pré-activation permet non seulement d’optimiser la performance, mais aussi d’augmenter la confiance et de réduire l’anxiété.
Transposition pédagogique : Pour un formateur, préparer mentalement une session, imaginer les réactions possibles des apprenants, anticiper les questions ou visualiser la dynamique de groupe permet d’arriver plus serein et d’être plus adaptable en direct. Pour un apprenant, la visualisation peut être intégrée sous forme d’exercices guidés pour favoriser l’auto-efficacité et renforcer la mémorisation. Voilà encore un exemple où la pédagogie et plasticité cérébrale se rejoignent parfaitement.
1.2. Modularité et recombinaison : la recette du succès en pédagogie et plasticité cérébrale
Les neurones de la perruche sont spécialisés pour des sons harmoniques (proches des voyelles), pour des sons bruités (consonnes), ou pour des sons mixtes. On retrouve une logique proche de nos phonèmes4. Cette capacité à réutiliser et recombiner ces modules est ce qui permet à l’oiseau d’imiter des sons nouveaux et de créer des variations infinies.
Transposition pédagogique : Imaginez que vos compétences pédagogiques soient comme ces modules sonores. Plutôt que de répéter un même scénario ou une même activité, vous pouvez les déconstruire et les recombiner selon les besoins de chaque groupe ou situation. Cette approche modulaire favorise la flexibilité, la créativité et le transfert des apprentissages. Elle développe aussi la capacité d’adaptation, essentielle dans un monde éducatif en constante évolution. Une belle démonstration du lien puissant entre pédagogie et plasticité cérébrale.
1.3. Composer au lieu d’exécuter : une inspiration gourmande

Pour illustrer concrètement cette idée, laissez-moi partager une anecdote inspirante :
« Un jour, j’ai lu l’histoire d’un chef étoilé qui, lors d’un concours, a reçu une boîte surprise d’ingrédients imposés. Parmi eux : du chocolat, des sardines, et des tomates vertes. Tout le monde a paniqué.
Mais lui, très calmement, a commencé à décomposer chaque ingrédient : « Qu’est-ce que je peux en faire ? Qu’est-ce qui peut se marier ? » Il n’a pas cherché à tout réinventer : il a pris des techniques qu’il maîtrisait déjà (caramélisation, émulsion, fumage) et les a combinées différemment.
Résultat ? Il a créé un plat original qui a bluffé le jury. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu : « Je n’ai pas cherché une recette, j’ai cherché des alliances. Je n’ai pas pensé en termes d’ingrédients, mais en termes de « briques » de techniques que je pouvais recombiner. »
Ce chef n’était pas simplement un exécutant : il était un compositeur. Et c’est exactement ce que nous pouvons faire en pédagogie : devenir des « compositeurs » de nos compétences, capables de réutiliser et réinventer nos briques pour créer quelque chose d’unique, peu importe la situation. »
2. L’importance de la structure : base de la pédagogie et de la plasticité cérébrale
Chez la perruche, la capacité à improviser repose sur une architecture neuronale modulaire très fine, véritable socle de son adaptabilité vocale. Cette organisation démontre qu’avant de laisser place à la créativité, il faut d’abord structurer et stabiliser les bases.
Transposition pédagogique : De la même façon, en formation, il est essentiel d’avoir un cadre clair (objectifs, repères, progressions) avant d’encourager la créativité. La pédagogie et plasticité cérébrale se rejoignent ici : plus les bases sont solides, plus l’apprenant peut se sentir libre d’explorer et d’innover.
2.1. La structure invisible qui soutient la créativité
Ce qui fascine, c’est que malgré sa créativité apparente, la perruche s’appuie sur une structure neuronale très organisée. Les modules sonores sont soigneusement cartographiés dans son cerveau, formant une sorte de « carte » vocale.
Pour nous, formateurs, cette structure pourrait correspondre à notre cadre pédagogique : progression, repères, règles claires. Elle sert de socle à partir duquel la créativité peut s’exprimer librement sans se perdre. Cet équilibre est un pilier de la pédagogie et de la plasticité cérébrale.
Équilibre clé : Trop de structure → rigidité. Trop de liberté → dispersion. Trouver le juste milieu, c’est permettre l’exploration tout en offrant un filet de sécurité cognitif et émotionnel.
2.2. L’équilibre structure-créativité en action
Au-delà du cadre théorique, appliquer cet équilibre dans la réalité pédagogique permet d’offrir aux apprenants un espace sécurisé pour expérimenter. Il s’agit d’alterner des temps très structurés (exercices guidés, objectifs clairs) et des moments d’ouverture (exploration libre, projets créatifs). C’est cette alternance qui favorise la consolidation des acquis tout en développant la capacité d’adaptation et d’innovation, un principe clé de la pédagogie pour favoriser la plasticité cérébrale.
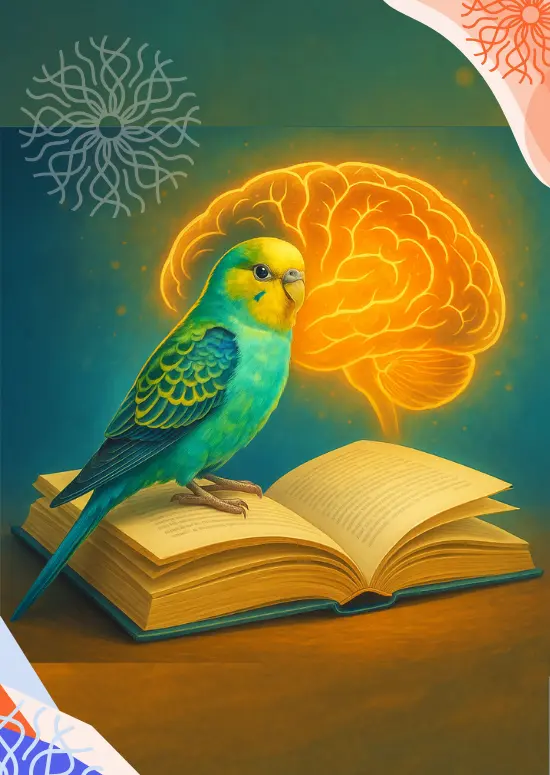
« L’activation de l’esprit inventif fait partie intégrante du processus d’apprentissage. »
— Eymery, C. 2012
3. Le rôle de la préparation mentale en pédagogie et plasticité cérébrale
La perruche prépare ses vocalisations en amont. Cette anticipation est visible dans son activité neuronale, qui augmente avant même le premier son.
En formation, préparer mentalement sa séance, visualiser les étapes, anticiper les imprévus sont des leviers puissants pour renforcer sa posture et sa capacité d’adaptation.
Pour l’apprenant, encourager la visualisation (imaginer réussir une présentation, répéter mentalement un geste technique) active les mêmes réseaux que la pratique réelle. C’est un formidable outil pour renforcer la confiance et la mémoire.
3.1. Le feedback interne : s’auto-ajuster en direct
Chez la perruche, l’AAC ne se contente pas de lancer le son, il s’ajuste en permanence, comme une oreillette interne qui permet d’adapter la hauteur et la qualité du son en direct.
En pédagogie, cela se traduit par la capacité à « écouter » ses apprenants, à lire les signaux faibles (expressions, gestes, postures) et à ajuster son discours ou son activité sur le moment.
Pour les apprenants, développer l’auto-feedback (capacité à s’auto-évaluer, à se corriger) est une clé pour renforcer l’autonomie et la consolidation des apprentissages.
3.2. La régulation émotionnelle : un complément indispensable
Chez la perruche, la capacité d’anticiper et de s’ajuster n’est pas seulement cognitive, elle est aussi émotionnelle. Lorsqu’elle produit des sons, elle doit réguler son état interne pour ne pas perturber la qualité vocale. Cette régulation émotionnelle est essentielle pour maintenir une performance fluide et cohérente.
Dans la formation, la régulation émotionnelle est tout aussi cruciale. Un formateur doit savoir gérer ses propres émotions — stress, impatience, excitation — pour rester à l’écoute et adaptable. Un état émotionnel stable lui permet de mieux accueillir les imprévus et de conserver une posture bienveillante.
Pour les apprenants, développer cette compétence signifie apprendre à reconnaître et à moduler leurs émotions pendant l’apprentissage. Cela peut passer par des exercices de respiration, des pauses réflexives ou des techniques d’auto-apaisement. Cette capacité favorise la concentration, réduit l’impact du stress et facilite la mémorisation à long terme.
Astuce pédagogique : Intégrer des moments de recentrage, encourager l’expression des ressentis et proposer des outils concrets (comme un carnet d’émotions) renforcent la capacité des apprenants à réguler leurs émotions et à s’impliquer activement dans leur progression.
4. Plasticité cérébrale et pédagogie : moteur de la progression
La capacité de la perruche à produire de nouvelles vocalisations tout au long de sa vie illustre la neuroplasticité : le cerveau reste capable d’apprendre, de s’adapter, et de se réorganiser, même adulte.
En pédagogie, cela nous rappelle que l’apprentissage n’est pas réservé à l’enfance. Chacun peut continuer à évoluer, à condition de créer des environnements stimulants, sécurisants et engageants.
Astuce pratique : Favoriser des défis progressifs, célébrer les micro-progrès, introduire des variations ludiques… autant de façons de stimuler la dopamine et d’ancrer les nouvelles compétences.
4.1. Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP)
L’étude suggère que la perruche n’est pas qu’un simple imitateur, elle est un véritable « compositeur » sonore. Cette capacité nourrit son sentiment de maîtrise.
Chez nos apprenants, renforcer le SEP passe par des expériences réussies, des feedbacks positifs, et la reconnaissance des progrès, même petits. Plus un apprenant se sent capable, plus il ose expérimenter et s’adapter.
En formation, on peut soutenir le SEP par :
- des mini-défis atteignables,
- des feedbacks fréquents et bienveillants,
- des activités où l’apprenant se sent acteur plutôt que spectateur.
4.2. Singularité et universalité
Chaque perruche a un répertoire unique, mais la structure neuronale sous-jacente est commune. De même, chaque apprenant a son style, ses besoins, son rythme, tout en partageant des bases cérébrales similaires.
Cela justifie l’importance de la différenciation pédagogique, de l’individualisation des parcours et de la prise en compte des singularités. Il ne s’agit pas d’un luxe, mais d’un levier central pour mobiliser le potentiel de chacun.
Conclusion : que retenir pour notre pédagogie ?
Pour composer une pédagogie vivante et inspirée de la plasticité cérébrale, voici quelques clés concrètes :
- Privilégier des « briques » pédagogiques modulables et recombinables.
- Allier structure et créativité, comme un cadre solide pour permettre l’improvisation.
- Encourager la préparation mentale et la visualisation.
- Développer la capacité d’auto-feedback et l’auto-ajustement.
- Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle par des défis progressifs et du feedback positif.
- Penser différenciation et singularité, tout en s’appuyant sur les mécanismes universels du cerveau.
La perruche nous rappelle qu’apprendre, c’est avant tout jouer, essayer, ajuster, explorer. C’est un processus vivant, plastique, jamais figé. En tant que formateurs, enseignants, éducateurs ou AESH, nous pouvons nous inspirer de cet art d’improviser pour aider nos apprenants à composer leur propre mélodie d’apprentissage.
🎶 Et si, comme la perruche, nous osions chaque jour chanter un peu différemment ?
Ce voyage dans le cerveau d’une perruche n’est pas qu’une curiosité scientifique : il offre une source d’inspiration concrète pour concevoir des séances plus engageantes, soutenir la motivation et encourager l’adaptabilité chez vos apprenants.
Pour aller plus loin et découvrir des outils concrets pour motiver, engager et soutenir vos élèves ou stagiaires, je vous invite à télécharger mon guide pratique gratuit. 💡
👉 Retrouvez également des conseils exclusifs et des contenus inspirants sur mon compte Instagram : @cateymery. Ensemble, faisons évoluer la pédagogie vers plus de vie et d’impact !
- Yang, Z., Long, M.A. Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks. Nature 640, 427–434 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08695-8 ↩︎
- La perruche ondulée, en anglais budgerigar (nom scientifique : Melopsittacus undulatus). ↩︎
- AAC = Anterior Arcopallium, Central nucleus (région du cerveau impliquée dans le contrôle moteur vocal de la perruche.) ↩︎
- Un phonème est la plus petite unité sonore d’une langue qui permet de distinguer un mot d’un autre. Chaque langue a un inventaire limité de phonèmes (ex. : en français environ 36, en anglais 44, en italien 30, en espagnol de 24 à 27 selon les régions). Dans la production de la parole (et dans l’étude comme celle sur les perruches), les phonèmes sont les « briques » sonores que le cerveau assemble pour produire des mots. ↩︎